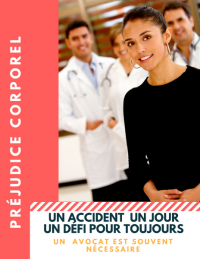Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Préjudice d'anxiété et transmission des obligations : jurisprudence renforcée
Résumé succinct :
La Cour de cassation casse partiellement les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avaient déclaré irrecevables les demandes des salariés pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante. La Cour rappelle que, dans le cadre d'une scission, toutes les obligations liées à la branche d'activité transférée sont transmises à la société bénéficiaire, sauf clause contraire expresse. Elle précise également que le délai de prescription court à partir de la connaissance par les victimes du risque à l'origine de leur préjudice.
Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits :
Onze salariés ont travaillé entre 1965 et 1978 pour la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC), exposés à l'amiante.
En 1982, l'activité a été reprise par la société Normed dans le cadre d'une scission partielle d'actif.
En 2000, un arrêté ministériel a inscrit l'activité de Normed sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
En 2011, les salariés ont saisi les prud’hommes pour obtenir réparation du préjudice d’anxiété.
Procédure :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence (11 avril 2013) :Les demandes ont été déclarées irrecevables :Les salariés n'étaient pas employés par Normed.
La prescription de trente ans était expirée.
Cour de cassation :Les salariés forment un pourvoi, contestant les interprétations de la cour d’appel.
Articles évoqués et reproduction
Article L. 236-3 du Code de commerce :
Sauf dérogation expresse, l’apport partiel d’actif emporte transmission universelle des biens, droits et obligations attachés à la branche d’activité apportée.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227965
Article 2224 du Code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430421
Raisonnement de la Cour de cassation :
Transmission universelle des obligations :
Lors d'une scission, toutes les obligations liées à l’activité transférée sont transmises à la société bénéficiaire, sauf clause expresse contraire.
La cour d’appel n’a pas correctement interprété le traité d'apport partiel, violant ainsi l'article L. 236-3 du Code de commerce.
Prescription :
Le délai de prescription commence à courir à partir de la publication de l'arrêté ministériel (2000), car les salariés ont alors pris connaissance du risque à l'origine de leur préjudice.
Réparation du préjudice d’anxiété :
Ce préjudice résulte de l’exposition prolongée à un risque élevé de développer une maladie grave, indépendamment de la réalisation de la pathologie.
Décision :
La Cour casse les arrêts attaqués et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Conséquences juridiques et analyse de la jurisprudence postérieure
Conséquences immédiates :
Clarification des règles de transmission universelle des obligations lors des scissions.
Alignement du point de départ de la prescription sur la prise de connaissance du risque par les victimes.
Évolution jurisprudentielle :
Cette décision confirme les principes posés dans l'arrêt du 11 mai 2010 (Cass. soc., n°09-42.241), qui reconnaît le préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à l’amiante.
Elle est complétée par l’arrêt du 5 avril 2019 (Cass. soc., n°18-17.442), qui élargit la reconnaissance du préjudice d’anxiété à d'autres contextes professionnels.
Analyse critique des décisions postérieures :
La jurisprudence postérieure tend à renforcer les droits des salariés, mais la multiplication des critères pour reconnaître le préjudice d’anxiété peut complexifier les litiges.
L’arrêt de 2019, bien qu'innovant, a été critiqué pour le risque de banalisation du concept de préjudice d'anxiété, initialement limité à des situations spécifiques d’exposition prolongée à des substances dangereuses.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du préjudice corporel - Droit judiciaire
- mars 2025
- Indemnisation des victimes : la Cour de cassation encadre la réparation (2024)
- Préjudice de la victime décédée : la Cour de cassation rappelle la primauté de la réparation intégrale
- Préjudices corporels – Comprendre leur évaluation et leur indemnisation
- Erreur médicale et indemnisation – Quels recours pour les victimes ?
- Indemnisation d’un accident de la route – Vos droits et les étapes clés