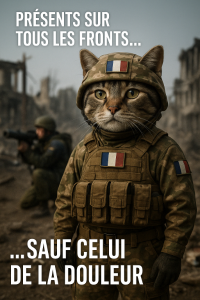Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Conflit russo-ukrainien : analyse historique, identitaire et géopolitique d’une guerre évitable
1. La construction géohistorique de l’Ukraine : entre périphérie stratégique et territoire disputé
Le terme Ukraine tire son origine de l’ancien slave Oukraïna, qui signifie littéralement « marche », c’est-à-dire une zone frontalière ou périphérique. Ce vocable, à lui seul, illustre la vocation historique de cette région : servir de territoire tampon aux marges de l’espace russe, notamment face aux incursions ottomanes, tatares ou polono-lituaniennes. Il ne s’agissait donc pas, à l’origine, d’un État doté d’une souveraineté pleine et entière, mais d’un espace d’interface entre empires, souvent dominé, rarement autonome.
La Rus' de Kiev, racine revendiquée par trois nations
L’histoire médiévale de la région est dominée par la Rus' de Kiev, un ensemble politique slave oriental fondé au IXe siècle, qui s’étendait sur une large portion du territoire correspondant aujourd’hui à l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie occidentale. Si la capitale était bien Kiev, cette entité ne peut être assimilée à l’Ukraine moderne. Elle est, de fait, revendiquée comme matrice historique commune par Moscou, Minsk et Kiev, tant du point de vue spirituel que politique. La conversion du prince Vladimir au christianisme orthodoxe en 988 fonde une identité religieuse et culturelle partagée, que la Russie impériale puis soviétique n’ont cessé de réactiver dans leur politique mémorielle.
La marginalisation du territoire ukrainien sous les empires
Après la dislocation de la Rus’ sous l’effet des invasions mongoles, la région connaît une période de fragmentation et de domination étrangère. Les territoires de l’actuelle Ukraine occidentale passent sous contrôle polonais et autrichien, tandis que l’Est, plus proche de la steppe pontique, reste faiblement structuré et devient un réservoir de colonisation tsariste dès le XVIIIe siècle. Catherine II lance une politique de développement de la « Nouvelle Russie » (Novorossiya), intégrant le sud de l’Ukraine actuelle (Odessa, Kherson, Dnipro, Crimée) dans une logique d’expansion impériale vers la mer Noire.
Il faut souligner que la majeure partie du territoire ukrainien actuel n’a jamais connu d’indépendance durable avant le XXe siècle. La brève République populaire ukrainienne (1917-1920), née du chaos de la Révolution russe, est rapidement absorbée par les Bolcheviks. L’Ukraine soviétique, créée en 1922 comme république constitutive de l’URSS, bénéficie d’une façade d’autonomie, sans jamais remettre en cause la centralité du pouvoir à Moscou.
Un État-nation tardif, issu de la dislocation soviétique
Ce n’est qu’en 1991, avec l’effondrement de l’Union soviétique, que l’Ukraine accède à une souveraineté pleine et reconnue sur la scène internationale. Toutefois, cette indépendance repose sur des frontières administratives héritées de l’ère soviétique, qui n’ont pas toujours tenu compte des réalités historiques, linguistiques ou culturelles des populations locales.
L’Est et le Sud du pays, notamment la Crimée et le Donbass, conservent une forte empreinte russe, tant dans la langue que dans la mémoire collective. L’Ouest, en revanche, se projette vers l’Europe centrale, avec laquelle il partage une histoire plus catholique, plus libérale et plus occidentalisée. Ces fractures géopolitiques internes ont constitué, dès les années 1990, un terreau d’instabilité structurelle, largement sous-estimé par les observateurs internationaux.
2. Une identité nationale en tension : la construction symbolique de l’ukrainien et les politiques de dérussification
Si l’indépendance politique de l’Ukraine date de 1991, son identité nationale reste, encore aujourd’hui, objet de débats tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Cette identité repose sur des fondations récentes, souvent réactives face à la domination russe, et sur une construction linguistique et culturelle qui n’a véritablement émergé qu’au XIXe siècle.
La langue ukrainienne : d’un idiome rural à un symbole d’État
La langue ukrainienne, bien que d’origine slave orientale comme le russe et le biélorusse, a longtemps été considérée comme un dialecte populaire ou paysan. Le russe dominait dans les institutions impériales, les milieux urbains, l’armée, l’administration, l’université. L’ukrainien n’a commencé à être codifié qu’à partir du milieu du XIXe siècle, sous l’impulsion d’intellectuels comme Taras Chevtchenko, poète et figure nationale emblématique, qui fit de l’ukrainien un vecteur de résistance culturelle au tsarisme.
Mais cette langue n’a été que très partiellement institutionnalisée. Pendant la période soviétique, bien que des efforts de « korénisation » (ukrainisation) aient été entrepris dans les années 1920, la domination du russe restait écrasante. L’ukrainien apparaissait comme une langue secondaire, rurale, souvent dévalorisée, sauf dans les milieux littéraires ou folkloriques.
La dérussification post-2014 : politique linguistique et rejet identitaire
Depuis la révolution de 2014 (dite « Euromaidan »), les autorités ukrainiennes ont entrepris une politique assumée de dérussification linguistique et culturelle, perçue comme une stratégie de rupture avec l’influence russe :
Le russe a été retiré du statut de langue régionale dans plusieurs oblasts ;
Les écoles russophones ont été progressivement transformées en établissements en langue ukrainienne ;
Des médias russes, des livres, des chaînes télévisées ont été interdits ou restreints ;
Une législation a imposé l’usage de l’ukrainien dans les services publics, les commerces, les administrations.
Ces mesures, bien qu’argumentées au nom de la consolidation nationale, ont eu pour effet de renforcer le clivage identitaire dans les régions russophones, en particulier dans le Donbass, la Crimée, et le sud du pays. De nombreux habitants ont perçu ces réformes comme une exclusion culturelle et politique, accélérant le processus de radicalisation anti-Kiev dans ces zones.
Une identité unificatrice encore fragile
À ce jour, l’identité nationale ukrainienne repose essentiellement sur trois piliers :
La langue ukrainienne comme fondement culturel central ;
L’européanisation comme projet politique et civilisationnel ;
L’anti-russisme comme référentiel mobilisateur.
Or, cette identité, largement construite en opposition, peine à intégrer la complexité historique et culturelle du pays. Elle reste fragile car l’adhésion populaire à ce modèle n’est ni homogène, ni universelle, notamment dans les régions historiquement tournées vers la Russie.
3. Crimée et Donbass : entre légalité internationale et mémoire impériale
La Crimée : un transfert soviétique à portée symbolique… devenu explosif
Le 19 février 1954, le Praesidium du Soviet suprême de l’URSS décide de transférer la Crimée de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) à la République socialiste soviétique d’Ukraine. Présenté à l’époque comme un geste symbolique pour célébrer les 300 ans de l’union entre l’Ukraine et la Russie (traité de Pereïaslav, 1654), ce transfert est opéré sans référendum populaire ni réelle consultation démocratique.
En 1991, ce changement administratif prend une dimension nouvelle. La Crimée devient ukrainienne de jure, en vertu du principe d’intangibilité des frontières internes de l’URSS reconnu par le droit international après sa dislocation. Or, la Crimée est historiquement :
Majoritairement peuplée de Russes ethniques (environ 60 % en 2014)
Stratégiquement cruciale pour la flotte russe de la mer Noire (base navale de Sébastopol),
Et profondément liée à l’imaginaire impérial russe.
L’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, consécutive à un référendum non reconnu par la communauté internationale, repose ainsi sur une logique mémorielle et stratégique, en contradiction manifeste avec le droit international.
Le Donbass : un bastion industrialo-russophone marginalisé
Le Donbass, région minière et industrielle née de la politique tsariste puis soviétique de développement économique du sud-est, est historiquement peuplé de travailleurs russophones, souvent originaires de Russie. Durant l’ère soviétique, cette région fut un des pôles économiques majeurs de l’URSS. Or, après l’indépendance ukrainienne, le Donbass connaît :
Un déclin économique brutal, lié à la désindustrialisation
Une marginalisation politique dans les équilibres nationaux,
Et un désenchantement culturel, face à la montée d’un nationalisme ukrainien perçu comme excluant.
Les mouvements séparatistes de Donetsk et de Louhansk en 2014, soutenus par Moscou, s’enracinent dans ce ressentiment post-soviétique autant que dans une stratégie géopolitique.
4. L’Ukraine post-2014 : dérussification accélérée et alignement occidental
L’Euromaidan : entre soulèvement populaire et réalignement géopolitique
La révolution de 2014, déclenchée par le refus du président Ianoukovitch de signer un accord d’association avec l’Union européenne, marque un tournant radical dans l’histoire contemporaine de l’Ukraine. Le soulèvement populaire débouche sur un changement de pouvoir rapide, immédiatement reconnu par les chancelleries occidentales. Moscou y voit un renversement illégitime de l’ordre constitutionnel ukrainien, interprété comme le fruit d’une ingérence étrangère directe.
L’ombre de l’OTAN et l’influence américaine croissante
Depuis 2014, les relations de l’Ukraine avec l’Occident s’intensifient :
Multiplication des coopérations militaires avec les pays de l’OTAN ;
Implantation de conseillers stratégiques et structures de gouvernance alignées sur les standards euro-atlantiques ;
Développement de programmes de formation, de soutien logistique, de livraison d’armement et de financement.
Pour la Russie, cette dynamique est perçue comme un encerclement stratégique, contraire aux engagements verbaux pris lors de la réunification allemande (1990), selon lesquels l’OTAN ne s’étendrait pas « d’un pouce vers l’Est » (formule controversée). L’Ukraine devient alors le théâtre d’un affrontement indirect entre puissances rivales, sur fond de guerre d’influence.
5. Une rétrocession négociée : une option écartée dès le départ
Au regard de la composition démographique et de l’histoire spécifique de certains territoires comme la Crimée ou le Donbass, des voix ont plaidé, avant et après 2014, pour une solution négociée fondée sur le principe de l’autodétermination. Cette approche aurait consisté à :
Organiser des référendums supervisés par la communauté internationale,
Garantir les droits culturels et linguistiques des populations russophones,
Envisager une forme de fédéralisme ou de statut spécial pour ces régions.
Mais cette voie a été rapidement écartée, aussi bien par les autorités ukrainiennes que par leurs soutiens occidentaux, en vertu du principe d’intangibilité des frontières. En parallèle, la Russie a privilégié une solution unilatérale (annexion) au détriment du droit international.
6. Le droit international face à l’histoire : deux légitimités irréconciliables
Le conflit russo-ukrainien met en lumière une tension structurelle entre :
Le principe de souveraineté étatique et de non-ingérence (article 2 §4 de la Charte des Nations Unies),
Et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, régulièrement invoqué par Moscou.
Or, la doctrine contemporaine privilégie la stabilité des frontières existantes, en particulier celles issues de la décolonisation ou de la dislocation d’États fédéraux. La reconnaissance internationale des frontières de l’Ukraine en 1991 repose notamment sur le mémorandum de Budapest (1994), par lequel la Russie s’engage à respecter l’intégrité territoriale ukrainienne en échange de la dénucléarisation du pays.
Dès lors, même si l’argument historique russe est compréhensible sur le plan identitaire, il ne saurait fonder une annexion en violation du droit international.
7. Une guerre inutile : bilan humain et matériel d’une impasse stratégique
L’enlisement du conflit depuis 2022 a entraîné un coût humain et matériel considérable :
Plus de 500 000 morts et blessés civils et militaires cumulés ;
Des millions de réfugiés et déplacés internes ;
Des villes entières détruites, comme Marioupol, Bakhmout ou Severodonetsk ;
Une économie ukrainienne dévastée, dépendante de l’aide extérieure ;
Un isolement international croissant pour la Russie.
Pendant ce temps, les grandes puissances ajustent leurs doctrines, testent leurs armements et réorganisent leurs alliances. Le conflit, dans sa durée, semble servir les intérêts stratégiques de quelques acteurs globaux, au prix du sacrifice massif des populations civiles et de la destruction de l’infrastructure d’un État européen.
Conclusion : entre mémoire impériale et réalisme diplomatique, une guerre qui aurait pu ne pas avoir lieu
Le conflit russo-ukrainien, loin de n’être qu’une guerre d’agression ou une défense d’un territoire, révèle une collision entre l’histoire longue et les normes modernes, entre l’identité mémorielle et la légalité post-guerre froide.
À défaut d’avoir su intégrer les populations russophones dans un projet national inclusif, et en refusant toute solution de compromis territoriaux négociés, la voie de la diplomatie a été sacrifiée. Aujourd’hui, la paix ne pourra advenir sans une reconnaissance mutuelle des intérêts vitaux, une relecture honnête des trajectoires historiques, et une remise en cause des logiques de confrontation systémique.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Billet d'humeur
- avril 2025
- mars 2025
- janvier 2024